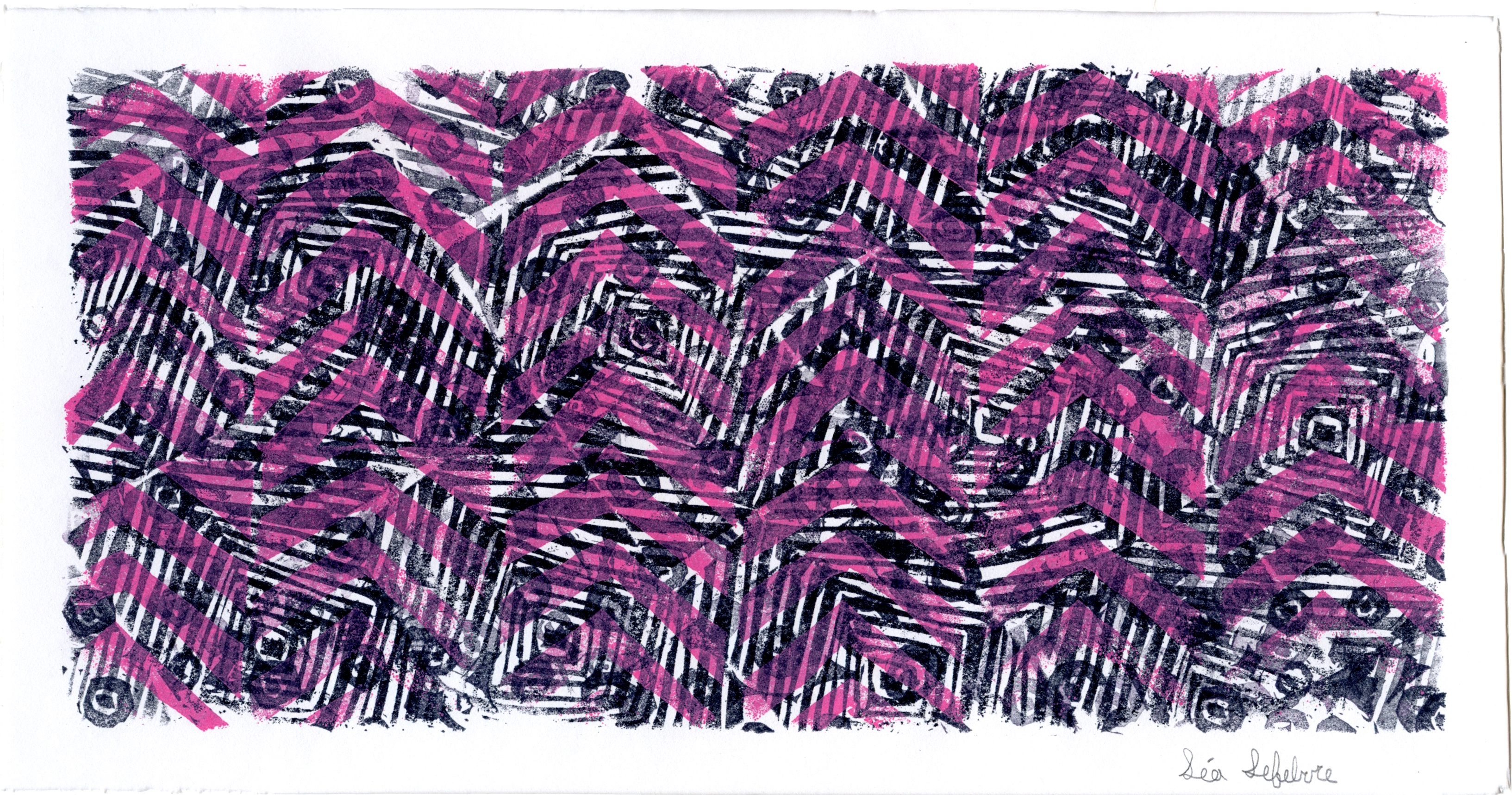
Crédit image: Léa Lefebvre, Collège de Bois-de-Boulogne
Cette nouvelle a précédemment été publiée dans la revue l’Inconvénient.
Mon ami ne touche pas le sol. Des pieds à la tête, tout son corps est dans les nuages. En fait, je me demande parfois s’il n’est pas lui-même un nuage tellement la matérialité et la pesanteur ne semblent pas avoir de prise sur lui. Au moment de rédiger ce récit, j’essaie de rappeler son image à mon souvenir, mais je n’y parviens pas. Est-il vieux ou jeune, beau ou laid ? Ses yeux sont-ils bleus, gris ou verts ? Est-il grand, est-il petit ? Je ne saurais vous le dire avec précision, car ce qui frappe, lorsqu’on le connaît, c’est son étrange personnalité qui défie tous les stéréotypes.
J’ai rencontré Christian pour la première fois à l’occasion de la comédie musicale Don Quichotte que nous avions montée mes amis et moi en cinquième secondaire. Les comédiens, les musiciens et même les techniciens qui ont participé à cette représentation s’en souviennent tous avec nostalgie. Habituellement, les pièces de théâtre des étudiants de secondaire sont bancales et maladroites : l’éclairagiste oublie d’envoyer un faisceau lumineux sur la scène et les comédiens se retrouvent soudainement perdus dans l’obscurité, un comédien joue de façon mécanique et sans émotion et tel autre a tout simplement oublié son texte. Cependant, à l’occasion de cette pièce, rien de tout cela ne se produisit et on eût dit que toute la production était touchée par la grâce.
Christian jouait Sancho, tandis que Don Quichotte était interprété par un certain Antoine Grasset. Si la personnalité des comédiens et leur biographie avaient influencé la distribution des rôles, Christian, le rêveur, aurait plutôt hérité du rôle de Don Quichotte, tandis qu’Antoine, le réaliste, aurait obtenu le rôle de Sancho. Antoine est aujourd’hui comptable agréé et il mène une vie aussi prosaïque et banale que la mienne… Mais les deux comédiens s’étaient fort bien débrouillés et leur personnalité respective n’a pas transparu pendant la représentation.
J’étais l’aîné de Christian de deux ans. À l’époque de la comédie musicale, il était en secondaire trois et moi en secondaire cinq. À titre d’aîné et de metteur en scène, je jouissais alors d’un certain ascendant sur Christian et, douze ans plus tard, je crois ne pas l’avoir perdu. Christian était alors un homoncule ; il n’avait pas encore mué et lorsqu’il chantait sa voix était si aiguë qu’on eût dit celle d’une femme. Les spectateurs riaient bien sûr à chacune de ses apparitions et, à la fin de la pièce, il fut longuement ovationné pour le comique de son interprétation.
Je perdis Christian de vue pendant quatre ans. Je le rencontrai de nouveau, par hasard, à l’occasion d’un cours sur la littérature française de la Renaissance à l’université McGill. C’est alors que j’appris vraiment à le connaître et qu’il devint l’un de mes grands amis. Sa voix avait mué ; il avait pris du poids et des muscles. Il s’entraînait. Il aimait citer des proverbes latins : « Mens sana in corpore sano », me dit-il quand je lui fis part de ma surprise à propos de sa forme physique.
À cette époque, j’achevais un bac en droit, tandis qu’il débutait son parcours en études classiques. Le cours de littérature française nous était crédité comme cours complémentaire. Le professeur était passionnant. C’était un humaniste, du moins, c’est le seul mot qui me vient à l’esprit pour décrire un professeur qui ne se perd pas dans des formules jargonneuses et sait parler autant au cœur qu’à l’esprit. Il avait une belle voix et il s’en servait pour toucher le cœur des étudiants. Lorsqu’il nous lisait, avec une sorte de langueur suave, des poèmes de Du Bellay et de Ronsard, tous les étudiants de la classe se taisaient et l’on n’entendait que le son de sa voix grave et harmonieuse.
À l’époque, j’avais déjà amassé un petit magot en travaillant comme secrétaire dans un cabinet d’avocats ; j’étais en couple avec la même fille depuis trois ans. Elle étudiait en pharmacie. D’ici quatre ou cinq ans, nous disions-nous, nous serions capables de nous acheter une maison. Ma vie avait donc des contours bien définis. Je me fixais des objectifs et je les atteignais toujours : « il faut être patient, constant et travaillant, c’est la clé du succès », me répétai-je souvent. Et pourtant, je peux dire qu’à ce moment précis de mon existence, j’ai éprouvé brièvement, mais profondément, le désir de tout lâcher pour partir à l’aventure.
Pour la première fois de mon parcours scolaire, je ne me forçais pas pour assister aux cours et pour compléter mes lectures obligatoires. Mon cœur, tenu en laisse par les pensums de la formation de droit, pouvait enfin s’épancher dans ce cours de littérature. Je décrochai des résultats excellents. Je pensai un temps à abandonner mes études de droit pour des études en lettres, mais je me ravisai et je continuai à bûcher sur le code civil.
Christian obtint des résultats moins satisfaisants que les miens, non pas parce qu’il était moins brillant que moi – je crois en effet qu’il est supérieurement intelligent – mais bien parce qu’il manquait de constance et d’opportunisme. Une sorte de fascination pour l’œuvre de Rabelais s’était emparée de lui. Nous n’étions tenus de lire que quelques extraits du Pantagruel, mais lui le dévora en entier et il fit ensuite de même avec le Gargantua si bien qu’il négligea les autres œuvres au programme. Selon lui, Rabelais était génial non seulement à cause de son prodigieux don de l’invention verbale, mais surtout parce qu’il avait inventé « le rire régénérateur ». « C’est le seul qui sait rire d’autrui sans tomber dans la satire, me disait-il avec enthousiasme. C’est un rire immense et généreux ! Rabelais rit de tout le monde et peut-être surtout de lui-même, pas seulement d’une classe sociale ou d’un individu en particulier. »
Il était excessif dans tout ce qu’il entreprenait et je crois que c’est pour cela qu’il appréciait Rabelais, ce grand maître de l’excès. Je remarquai assez vite qu’il avait des engouements éphémères : il changeait d’idée comme une girouette change de direction au gré du vent. Il admirait les Anglais : « Quel grand peuple ! s’exclama-t-il alors qu’on marchait sur le campus de McGill. Tout leur semble facile. Regarde comme les étudiants anglophones ont confiance en eux. Ils sont nonchalants; ils traînent des pieds… Ils savent, même inconsciemment, qu’ils forment l’élite financière de Montréal. Tout leur est facile. Les portes leur sont ouvertes ! Les filles portent des babouches… On dirait qu’elles vont à la plage et non dans une salle de cours. »
Il s’agitait souvent quand il parlait. Il gigotait. Il avait des tics nerveux. Il ne tenait pas en place ; on eût dit qu’il allait s’envoler ou bien qu’il allait exploser. On eût dit qu’il parlait par étincelles, par flammèches. Avant de nous faire part de son opinion sur un sujet particulier, il n’introduisait pas toujours le point en question et il fallait tenir la bride serrée pour le suivre dans ses raisonnements sinon on était complètement perdus. Il s’exprimait par ellipses et aimait particulièrement se mouvoir sur ce que j’appelais « les plaques tectoniques » du savoir. Il aimait ratisser large, il se sentait à l’aise dans les théories abstraites et les concepts englobants ; s’il avait vécu au XVIIIe siècle, il aurait certainement adhéré à la théorie des climats de Montesquieu. Il détestait les détails, détails avec lesquels j’étais constamment aux prises dans ma pratique d’avocat…
Comme il était doué pour la comédie, il aimait cabotiner et il se lançait souvent dans des imitations comiques. L’une que je goûtais le plus était celle du pédant universitaire. Il lissait sa barbe d’une main, il ajustait ses lunettes et il déclarait avec un accent sorbonnard : « Tout compte fait, il faudrait analyser davantage la polyphonie du signifiant pour mieux saisir l’étendue de la différance dans une perspective totalisante. » Il aimait à se moquer de ce qu’il appelait les étudiants-machines qui gobaient la matière et qui la recrachaient à l’examen. « Ces étudiants obtiennent des notes excellentes, disait-il, mais ils n’ont aucun esprit critique. Ils ne se posent aucune question. Ils écoutent le professeur avec une attention maniaque. Ils écoutent, ils notent, ils écoutent, ils notent. Ce sont des sténographes.
– Mais je suis ainsi, lui répliquai-je de bonne foi.
– Oui, mais toi, que veux-tu, tu es un ami… »
Et nous avons éclaté d’un grand rire.
À l’été, après notre cours sur la Renaissance, il dénicha un emploi de gardien de sécurité. Deux soirs par semaine, il prenait des cours de latin dans une école privée. Puis, à l’automne, il devint préposé au théâtre Saint-Denis où se produisent plusieurs humoristes québécois. Il détesta cet emploi : « je déteste les humoristes; ce sont des imbéciles. » Enragé, il quitta le Saint-Denis après deux mois. Il lut Tolstoï : « Tolstoï est un titan ! Et il est sage ! » Il lut Dostoïevski : « Dostoïevski est un titan, mais il n’est pas sage. » Il collabora à L’Indépendantiste, revue qui prône la souveraineté du Québec. Il se présenta pour le Bloc québécois dans la circonscription de Mont-Royal et obtint 3 % des voix exprimés au suffrage. Il collabora pendant quelque temps avec un député du PQ, proche des milieux environnementalistes. Il militait aussi pour la construction de logements sociaux à Montréal. « Il faut absolument sortir le peuple de la misère, me disait-il. » À cette époque, il lisait Hubert Aquin. C’est un grand écrivain, c’est certain, mais comme à peu près tous les écrivains québécois, il est dépressif. Moi, j’ai besoin de héros positifs… Regarde les écrivains américains… La découverte de l’Ouest… Le self-made man… Les chercheurs d’or… Mark Twain… De la vitalité ! De la vitalité que diable ! Mais non, nous, on a seulement des dépressifs. » À l’hiver, il entreprit une maîtrise en littérature française et il se trouva un emploi de correcteur pour l’épreuve uniforme de français au cégep : « Les étudiants sont nuls, me dit-il ; certains ne savent même pas écrire correctement leur nom de famille. On s’en va tout droit vers un échec national. »
Six mois plus tard, il eut une violente dispute avec deux rédacteurs socialistes de L’Indépendantiste et il n’écrivit plus jamais pour cette publication. Il lisait Barrès. « Quel grand écrivain! Enfin, de l’énergie, de la passion ! » Ses vues sociales changèrent. Il se reconnaissait maintenant dans l’idéologie conservatrice. « Au fond de moi, j’ai toujours été conservateur », me disait-il. Il lut la Bible. Il devint croyant. Il admirait Bush. « Bush poursuit une mission civilisatrice, estimait-il. Les États-Unis, c’est la grande démocratie actuelle, les Américains sont un grand peuple. Comment ne pas les admirer ! » Il aimait la série des Rocky. Il appréciait le message politique : « C’est une culture de l’effort qui est transmise dans ce film… La gauche nous amène tout droit vers la passivité, mais Rocky, c’est l’effort, c’est la persévérance. »
Pendant un certain temps, il pensa travailler comme GO au club Med : « Il faut découvrir le monde ! me disait-il. Ça sera une expérience à la Houellebecq. Je fais du kayak dans la journée, je donne le cours de danse sociale, j’assure l’animation à la piscine et, le soir, dans ma chambre, j’écris et je lis Caton l’Ancien. Beau programme ! En plus, je suis logé et nourri. » Ses amis et moi lui avons vivement déconseillé de tenter « l’expérience club Med » : en effet, comment un être, qui n’avait aucune aptitude sportive particulière et qui était incapable de supporter la présence d’une foule bruyante pendant plus d’une heure, aurait-il pu survivre au club Med ? Son CV avait été néanmoins sélectionné. Il se préparait pour l’entrevue : « Je me pratique à sourire », disait-il. Il s’était néanmoins assagi et, à la dernière minute, il avait tout envoyé paître : « Ils m’auraient exploité, disait-il. Toujours des activités… À peine le temps de manger… Et puis il faut toujours sourire, c’est fatiguant pour la mâchoire. » Deux mois plus tard, il s’enrôlait comme réserviste dans l’armée canadienne. Il apprécia l’expérience : « C’est une école de discipline », me disait-il. Il suivait des cours de tirs, il cirait ses bottes, il apprenait à utiliser une boussole, il faisait des push-up… Pendant tout ce temps, je travaillais cinquante heures par semaine dans un bureau d’avocats. Je naviguais dans le sillage d’un avocat spécialisé dans des affaires de droit civil qui était particulièrement reconnu pour sa connaissance approfondie du droit de passage. J’apprenais beaucoup et j’étais moi aussi en voie de devenir un spécialiste du droit de passage. Ma vie était aussi régulière qu’une montre suisse. J’étais maintenant marié et ma femme attendait un enfant. « Ce que j’admire c’est ta constance, me disait Christian. Je t’envie ; tu vas avoir une famille. » Et moi, secrètement, dans le coin de mon cœur, j’enviais mon ami…
Deux ans passèrent. Christian avait maintenant complété sa maîtrise en littérature française, tandis que j’avais déjà commencé à plaider. Depuis qu’il avait terminé sa maîtrise, mon ami était au chômage. Il n’en gardait pas moins la forme. Je ne sais pas comment diable il réussissait à trouver de l’argent, mais, aussi bizarre que cela puisse paraître, il me semblait qu’il menait une vie de pacha et que son existence était plus agréable que la mienne. Il lisait jusqu’aux petites heures du matin et c’est d’ailleurs une chose que je lui ai toujours enviée, moi qui ai de la difficulté à trouver dix minutes pour lire un bon roman. Il avait découvert Saul Bellow : « Saul Bellow, c’est le Mark Twain du XXe siècle », me dit-il. Il faisait de longues promenades : « Marcher, c’est philosopher ; tout le monde devrait marcher ! » Il trouva même l’argent nécessaire pour s’offrir une semaine à New York. Il en fut enchanté : « Montréal est dépressive, New York est hyperactive… New York, c’est le poumon du monde. Si New York est un jour anéantie, c’est toute l’humanité qui mourra. »
Un jour pourtant, il fut au bout de ses économies et la nécessité de se trouver un emploi se fit vivement ressentir. Christian rêva pendant un certain temps d’œuvrer dans la vente. Il voulait devenir agent immobilier. Il suivit une formation. « Tu sais, on peut facilement gagner 70 000 dollars la première année si on travaille d’arrache-pied. Ça me convient : la vie américaine, l’esprit industrieux, les transactions financières, le cellulaire qui sonne sans arrêt… »
– Mais quand auras-tu le temps de lire Saul Bellow avec cet emploi ? lui demandai-je.
Il ne sut répondre.
Nous étions en mai, les lilas embaumaient les rues de Montréal et les choses allaient se bousculer pour Christian…
J’ai déjà remarqué que les personnes timides se lancent parfois des défis et veulent se prouver qu’elles sont capables d’aller au-delà de leur caractère : c’est alors qu’elles peuvent poser des gestes que n’auraient jamais osé poser des personnes extraverties… Christian était un grand timide et c’est peut-être en partie pour cela qu’il avait voulu jouer le rôle de Sancho dans Don Quichotte. Ainsi, il m’apprit qu’il avait abordé une fille dans un café et qu’elle avait accepté qu’il s’asseye près d’elle. Ce fut le coup de foudre. Il l’aimait et elle l’aimait. Cela faisait bien quatre ans qu’il n’avait pas été amoureux. Il n’avait pas eu d’aventures non plus, car il était aussi chaste que Don Quichotte rêvant à sa Dulcinée du Toboso. Il était extatique : « Elle est d’une douceur exquise. Il y a quelque chose d’asiatique dans son comportement. » À peu près au même moment, mon ami Louis, qui était professeur de français dans un cégep, m’avertit que son département engageait des nouveaux professeurs. J’en avertis aussitôt Christian. Il balança par-dessus bord son projet de devenir agent immobilier et se prépara avec sérieux pour réussir son entrevue d’embauche. Il fut choisi. J’eus des nouvelles du déroulement de l’entrevue par l’entremise de mon ami : « Enfin, oui, ça c’est très bien passé. Moi je n’étais pas sur le comité de sélection bien entendu… Il ne fallait pas que j’influence le comité parce que je te connais… Mon collègue m’a dit que ça c’était très bien passé. Ton ami a de vastes connaissances littéraires et il était très bien préparé, je dirais même surpréparé. Il y a un seul bémol, on a peur qu’il soit… Comment dire… Un peu trop excessif. »
Christian avait hérité du cours 102, littérature française du romantisme à aujourd’hui. « Je vais leur faire lire Les Illusions perdues de Balzac, des extraits de Madame Bovary… Bah, seulement une cinquantaine de pages… comment ne pas lire au moins quelques pages de ce roman si l’on veut aborder le XIXe siècle), ensuite j’enchaîne avec Les Fleurs du mal de Baudelaire et je termine avec Les Particules élémentaires de Houellebecq. Beau programme ! Qu’est-ce que tu en penses ? » Cet été-là, il se réfugia deux semaines à l’abbaye Saint-Benoît-du-lac pour lire et pour préparer des notes de cours et des exercices. « Un peu de silence et beaucoup de livres, c’est tout ce dont j’ai besoin pour être heureux », me dit-il avec enthousiasme.
En septembre, un scandale éclata. Tout d’abord, Sophie, la copine de Christian, rompit avec lui. Je n’ai jamais vraiment su pourquoi, car il était très discret à propos de ses amours, mais je me doute que la décision de Christian de la quitter pendant deux semaines au profit de ses livres eût pu jouer en sa défaveur. D’autre part, mon ami n’est pas sans défauts et, comme Don Quichotte, il n’a pas la moindre idée de ce qu’est l’existence concrète et matérielle. À la vérité, je doute même qu’il soit capable de se faire cuire un œuf. Pendant quelques semaines, Sophie a peut-être trouvé que la vie de bohême que menait Christian était charmante, mais rapidement elle s’en est lassée. Mais il ne perdit pas pied et il commença « en lion » (telle était son expression) sa première session à titre d’enseignant.
Les deux premiers cours se déroulèrent comme un charme de l’avis même de Christian : « Ils sont motivés, beaucoup plus motivés que je le pensais. Les jeunes ont soif de culture ! Ma théorie, c’est que les étudiants aiment bien avoir un professeur exigeant ; ils comprennent bien que je les considère comme des êtres intelligents. Il y a des professeurs qui leur donnent des bandes dessinées à lire… Pff… C’est une insulte à leur intelligence. » Les étudiants devaient être heureux d’avoir un professeur aussi passionné que lui ; cela faisait changement de ces professeurs blasés qui donnent toujours les mêmes œuvres à chaque session et qui, au premier cours, se contentent de faire la lecture du plan de cours à leurs étudiants. Au troisième cours, pourtant, les problèmes commencèrent à affluer. Aux dires des étudiants, Christian était trop exigeant : les œuvres au programme comptaient à elles seules mille cent cinquante pages auxquelles il fallait rajouter les cent cinquante pages du cahier de notes de cours que mon ami avait lui-même préparé pour ses étudiants. En plus, il demandait aux garçons d’enlever leur calotte lorsqu’ils entraient dans la classe. « Ils me doivent du respect. Après tout, je suis le Maître », disait-il.
Les problèmes avaient remonté jusqu’au directeur des études. Aux dires de Louis, c’était un vieil homme bon et doux. Il avait demandé gentiment à Christian de réduire ses exigences en termes de lecture. « Si vous leur donnez mille pages à lire, ça me paraît raisonnable, vous ne trouvez pas ? Et pour les calottes, je suis de la vieille école, je suis comme vous, mais il me semble que c’est un règlement difficile à appliquer… » Christian avait refusé d’obtempérer à l’avis du directeur. Pour se venger, certains étudiants le chahutaient, d’autres étudiants tentaient de bonne foi de lire Les Illusions perdues, mais peu y trouvèrent plaisir.
Dégoûté, Christian démissionna en plein milieu de session sans laisser de préavis au Collège. « D’où il sort celui-là, mais d’où il sort ? J’ai trente ans d’expérience dans ce Collège, mais je n’ai jamais vu un énergumène pareil ! » se serait exclamé le vieux directeur des études après la sortie fracassante de Christian.
Je m’empresse de dire que s’il avait démissionné, ce n’était pas seulement par dégoût. Une cause peut-être plus profonde guidait la destinée de Christian. Il avait un ami en Ontario, à Mississauga, qui le pressait de le rejoindre. Le gouvernement conservateur, récemment élu, engageait, paraît-il, des conseillers politiques. Il avait aussi l’espoir de passer les examens d’entrée pour œuvrer dans la fonction publique fédérale. « La fonction de diplomate m’intéresse beaucoup. Rencontrer des ministres, manger des hors-d’œuvre, participer à l’inauguration d’un centre culturel… Il faut dire que c’est tentant ! » Une autre aventure attendait mon ami. « Le Québec, c’est terminé, disait-il. Je pars à Mississauga. De toute façon, les Québécois ne feront jamais l’indépendance. »
*
Mon existence se déroule dans la Constance et la Fixité alors que mon ami évolue dans l’Inconstance et le Mouvement. J’ai enfin compris que ces démissions fracassantes et ces brusques changements du cœur étaient le moyen qu’il avait trouvé pour faire durer une aventure qu’il voulait perpétuelle. Il désirait se mouvoir dans l’univers des possibles ; se fixer aurait signifié la mort de l’Aventure et du Rêve. Un an s’est écoulé depuis le départ de Christian. Il est toujours à Mississauga et, à mon grand regret, j’ai moins de nouvelles de lui depuis qu’il a quitté Montréal. Il vivote en effectuant divers boulots plus ou moins bien rémunérés bien qu’il ait passé avec succès les examens d’entrée de la fonction publique fédérale. Aux dires d’un ami commun, il serait vendeur à commissions dans une compagnie de climatisation. Qui d’entre nous deux est le plus heureux ? Moi, qui effectue un emploi grassement payé et qui ai les deux mains dans la réalité ou bien mon ami qui est pauvre et qui a la tête dans les nuages ? Je ne saurais répondre à cette question, mais j’éprouve parfois un pincement au cœur lorsque je compulse les notes du dossier d’un client ou alors que l’avocat de la partie adverse se perd dans des circonvolutions oratoires. C’est dans ces moments que la belle image de Don Quichotte, homme fantasque et fragile, cheminant sur sa monture dérisoire dans le désert hostile de la Mancha, revient me hanter.