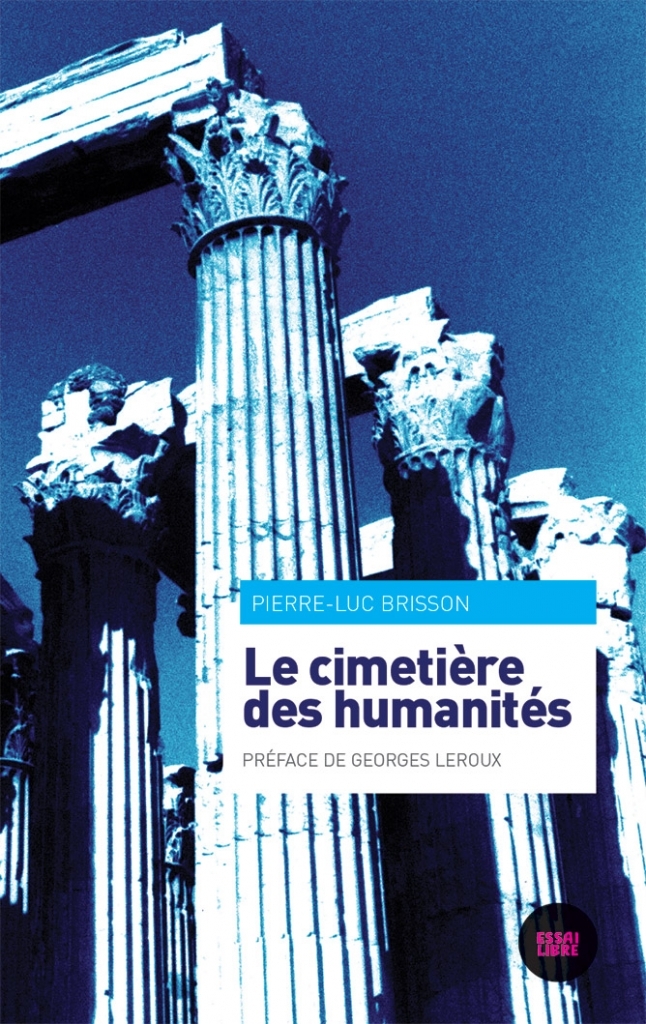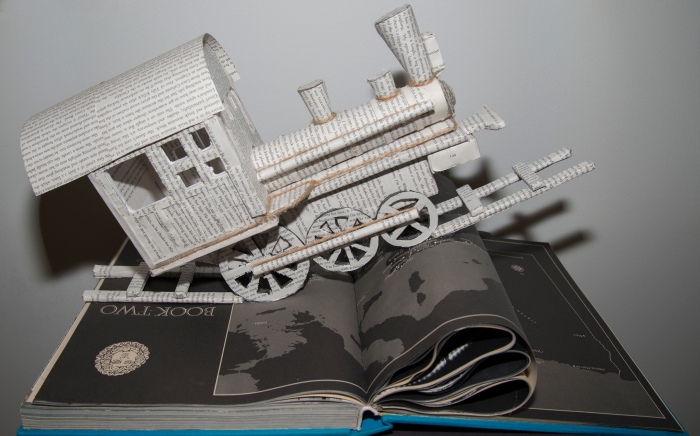
Une oeuvre de Nanor Janjikian
***
Arnaud Pelletier
Étudiant
Collège de Bois-de-Boulogne
Résumé
Dans la foulée du rapport Parent, l’État québécois a réformé en profondeur son système d’éducation dans le but de le rendre plus accessible. La création des cégeps, il y a de cela 50 ans, a grandement marqué le système québécois, de par sa formation générale et son accessibilité. Sur cette même lancée, le gouvernement du Québec a tenté à quelques reprises de réformer les établissements d’enseignement de la province. Cela a mené le ministère de l’Éducation à proposer une importante réforme en l’an 2000, qui visait à évaluer les étudiants sur leurs compétences et non leurs connaissances. En raison du bilan médiocre de cette réforme, il est important de se questionner par rapport aux conséquences que peut entraîner une volonté trop marquée de démocratiser l’éducation. En effet, il semble y avoir de nombreux effets pervers à cette réforme, dont la baisse de qualité globale de l’éducation et une connaissance générale émincée. Pour répondre à cet enjeu, un modèle d’éducation idéal est présenté selon la pensée de John Dewey, John Stuart Mill et, enfin, Friedrich Nietzsche. Ces visions bien souvent opposées semblent toutefois avoir certains éléments complémentaires. En effet, la volonté marquée de Dewey de favoriser l’accès à l’éducation, mêlée au libéralisme de Mill et à l’importance accordée par Nietzsche à la transmission de la culture classique, donne un portrait juste de ce à quoi un cégep devrait aspirer.
Dans L’Humaine Condition, Hannah Arendt critique le modèle d’éducation américain qui, selon elle, est en crise. Celle-ci serait causée par l’idéologie démocratique qui essaie de minimiser, voire même d’effacer, la différence entre chaque individu et, plus particulièrement, entre les professeurs et les élèves[1]. Depuis la parution du rapport Parent, en 1963, l’État québécois tente non seulement de fournir un « enseignement ouvert à tous, à tous les niveaux, mais aussi une orientation de chacun vers le genre d’études correspondant à ses goûts et à ses aptitudes[2] ». Cette volonté d’adapter le système d’éducation aux particularités des élèves afin de justement développer leurs « dispositions originelles », comme le dirait Kant, a poussé le gouvernement québécois à créer les cégeps, il y a de cela 50 ans. Après la mise en place de ces établissements, l’accès aux études supérieures a été nettement amélioré. Néanmoins, d’autres réformes ont éventuellement été jugées nécessaires afin de réellement démocratiser l’éducation. C’est ainsi qu’une nouvelle réforme secoue la province en l’an 2000. Celle-ci visait à ce que les établissements scolaires évaluent les élèves non pas seulement sur leurs connaissances, mais surtout sur leurs compétences, parfois même transversales. Pour le gouvernement de l’époque, l’importance accordée aux connaissances n’assurait pas une réelle compréhension de la part d’une partie importante des étudiants. Une revalorisation des compétences s’imposait donc afin d’augmenter le taux de diplomation, puisque d’apprendre de la sorte semble être plus accessible que d’apprendre par la simple transmission de connaissances. Or, il y a de nombreux effets néfastes causés par l’intention de favoriser la réussite du plus grand nombre possible. Certains avancent que le développement des étudiants les plus doués est inévitablement ralenti, alors que d’autres défendent plutôt que la priorité du système d’éducation devrait être de favoriser la réussite du plus grand nombre possible. Bien que cette question ait été traitée en long et en large depuis aussi longtemps que Platon, le débat autour de la démocratisation de l’éducation est particulièrement pertinent dans le cadre du 50e anniversaire des cégeps, puisque ces établissements ont été créés dans l’optique de rendre les études supérieures plus accessibles. Néanmoins, toute tentative d’augmenter le taux de diplomation, que ce soit au secondaire ou dans à l’université, peut comporter son lot d’inconvénients.
Nous sommes en droit de nous questionner par rapport à la mise en pratique des idéaux démocratiques en éducation. Les mesures mises en place par le gouvernement afin d’augmenter le taux de diplomation au secondaire et de faciliter l’accès aux études supérieures nuisent-elles à la qualité de l’éducation reçue dans les cégeps? Le duel entre compétences et connaissances est au cœur de la problématique. Il est essentiel, à mon avis, de faire en sorte que l’éducation se concentre à nouveau sur les connaissances plus générales et classiques qui se voient de plus en plus ignorées dans le cursus québécois, quitte à ce que le taux de diplomation diminue. L’importance accordée à celles-ci permettrait aux étudiants d’avoir accès à une Bildung (terme allemand désignant l’éducation, la culture et, surtout, « le processus visant à développer la meilleure version de nous-même[3] »). Je plaide donc pour que les établissements d’enseignement, tout particulièrement les cégeps, se concentrent sur la transmission d’un réel bagage culturel aux étudiants.
L’éducation progressiste
Premièrement, considérons la position de John Dewey, philosophe américain s’inscrivant dans le courant du pragmatisme, pour qui le progrès doit être l’objectif visé par tous les établissements d’enseignement. Tout d’abord, il est important de mentionner que Dewey considère que si l’humain vit dans un groupe social, c’est pour obtenir davantage en utilisant les autres[4] et que l’individualisme est bénéfique pour tout individu, puisque c’est le « produit du relâchement de la contrainte de l’autorité, de la coutume et des traditions » et cela lui permet de réellement penser par lui-même[5]. Dewey considère que le modèle d’éducation conservateur « ne tient pas compte de l’existence dans un être vivant de fonctions actives et spécifiques qui se développent au cours des processus de réorientation et d’association qui interviennent au contact de l’environnement[6] ». C’est pour cela qu’il propose de mettre l’accent sur le développement des compétences des jeunes et dénonce l’obsession qu’ont les établissements d’enseignement pour l’enseignement de l’histoire, puisque d’en faire le « matériel principal de l’éducation […] coupe le lien vital qui unit le présent au passé, et que [cela] tend à faire du passé un rival du présent, et du présent une imitation plus ou moins futile du passé[7] ». Or, il reconnait tout de même l’importance d’étudier le passé dans le seul cas où les leçons que nous pouvons tirer de l’histoire peuvent être utiles pour le développement de l’avenir.
Pour Dewey, il est impératif de prendre en considération les expériences des étudiants, car, selon lui, cela est la meilleure manière d’atteindre l’idéal de l’éducation démocratique : le progrès. Il écrit : « […] l’idéal de croissance aboutit à la conception que l’éducation est une réorganisation ou une reconstruction constante de l’expérience[8]. » Donc, une éducation progressiste permettrait de « façonner les expériences des jeunes de sorte qu’au lieu de reproduire les habitudes courantes ils contractent de meilleures habitudes[9] ». Bref, l’éducation idéale de Dewey est un système où l’histoire sert à changer le futur et où les étudiants partagent leurs expériences afin qu’ils puissent bénéficier d’une éducation morale convenable.
Dewey croyait en un système éducatif étatique et considérait que l’éducation devait être complètement accessible et tout en fournissant tout le matériel scolaire nécessaire aux plus démunis pour réellement supprimer les inégalités économiques et permettre à chaque individu « d’échapper aux restrictions du groupe social dans lequel il est né[10] ». Bref, le type d’éducation que Dewey souhaite fournir aux étudiants aurait comme idéal le progrès. Cela peut se faire à partir de la mise en commun des expériences des étudiants, permettant ainsi à tous de mieux développer leurs différentes compétences dans ces domaines.
Il est évident que Dewey applaudirait la réforme québécoise de l’éducation, puisque les fondements mêmes de celle-ci découlent de sa philosophie[11]. En effet, l’accent mis sur les compétences, conjugué à l’objectif initial de favoriser l’accès aux études supérieures, fait de la réforme un modèle d’éducation conforme aux idéaux de Dewey. J’estime néanmoins que Dewey considérerait que la raison pour laquelle le taux de diplomation a diminué chez certaines classes de la population est parce que nous n’évaluons pas assez les compétences et ne façonnons pas assez bien les expériences des étudiants.
La liberté de s’éduquer
Une deuxième perspective sur la question nous est fournie par le philosophe utilitariste John Stuart Mill, qui plaide avant tout pour un système libéral. Mill considère que les libertés individuelles priment sur les intérêts collectifs, ce qui fait de lui une des figures de proue de l’idéologie libérale classique. Ainsi, il considère que la véritable liberté est « d’assigner des limites au pouvoir », de telle sorte que tous soient libres de vivre comme ils l’entendent[12]. Un autre devoir primordial de l’individu consiste à se munir de protections par rapport à ce que Mill appelle la tyrannie de la majorité, soit la tendance de celle-ci « à vouloir imposer comme règles de conduite […] ses idées et ses coutumes à ceux qui les contestent[13] ». La société devrait donc être construite autour du principe de non-nuisance. À ce sujet, Mill écrit : « […] les hommes ne sont autorisés, individuellement ou collectivement, à interférer dans la liberté d’action de quiconque que pour assurer leur propre protection[14] ». Dans cette optique, le rôle de l’État serait plutôt d’assurer le respect de la liberté individuelle de chacun et, donc, d’intervenir seulement si une personne est nuisible pour une autre. De plus, la collectivité ne devrait avoir aucun mot à dire quant au mode de vie de l’individu et ne peut contraindre un individu à agir de telle ou telle manière sous prétexte que cela est meilleur pour lui, puisque celui-ci est souverain sur « lui-même, sur son corps et sur son esprit[15]».
Concernant l’éducation, il est essentiel pour Mill qu’elle soit entièrement axée sur le développement individuel et la culture de l’originalité. En effet, l’éducation doit assurer à tous la possibilité de cultiver « l’individualité de la puissance et du développement[16] ». Cela ne peut se faire, selon Mill, qu’en s’instruisant à l’aide de l’expérience, puisque « la force intellectuelle et la force morale, tout comme la force physique, ne s’améliorent qu’avec l’exercice[17] ». Ainsi, la véritable Bildung est acquise en partageant ses connaissances et, surtout, ses expériences avec les autres afin de favoriser une éthique de la discussion permettant de se rapprocher de la vérité. Si l’éducation ne doit pas être conduite par l’État, c’est en raison des risques d’endoctrinement qui y sont associés. Mill écrit : « Une éducation générale administrée par l’État n’est autre chose qu’un instrument à fabriquer des hommes sur un seul modèle[18] ». Mill propose un système d’enseignement privé dans lequel l’État s’assure que tous, même les plus défavorisés, aient accès à l’éducation[19].
Dans le débat autour du renouveau pédagogique québécois, on peut penser que Mill considérerait que la réforme est bénéfique au développement individuel, puisque le dialogue occasionné par le développement des compétences, souvent fait à l’aide d’activités de groupe, permettrait de favoriser une bonne éthique de la discussion et, par le fait même, permettrait aux individus de se rapprocher de la vérité. Néanmoins, Mill critiquerait sans aucun doute la mainmise institutionnelle de l’État québécois sur l’éducation, puisque cela implique souvent une certaine forme d’endoctrinement. Cette imposition des valeurs de la majorité est sans aucun doute un des plus grands problèmes pouvant toucher une société. Cela causerait une perte de l’individualité qui pourrait être difficilement réparée. Mill, à ce sujet, écrit :
L’uniformisation des caractères croît par ce dont elle se nourrit. Si on attend pour lui résister que la vie soit presque réduite à un type uniforme, alors tout ce qui s’écarte de la norme sera considéré comme impie, immoral, voire monstrueux et contre nature. L’humanité devient rapidement incapable de comprendre la diversité lorsqu’elle s’en est déshabituée pendant un temps[20].
Dans une perspective millienne, il est donc important que l’État cesse de jouer un rôle prédominant dans l’éducation et laisse le privé s’en occuper. Néanmoins, l’État se doit d’assurer un contrôle sur la qualité des institutions en imposant des « des examens publics à tous les enfants dès leur plus jeune âge[21] ».
L’éducation axée vers la culture
Notre troisième perspective sur l’éducation, celle de Friedrich Nietzsche, philosophe et philologue allemand de la seconde moitié du XIXe siècle, mise sur un retour aux valeurs aristocratiques. Ces valeurs permettent aux humains de vivre conformément à ce qu’il appelle une morale des maîtres, type de morale qui caractérise les grandes sociétés antiques[22]. Pour Nietzsche, la morale des maîtres permet d’agir réellement par-delà bien et mal, et ainsi atteindre un plus haut degré d’autonomie, car l’individu est, à ce stade, en mesure de se doter de ses propres valeurs[23]. La pierre angulaire de la philosophie nietzschéenne est la culture de l’individualité. Il écrit : « Il importe de se prouver à soi-même qu’on est destiné à l’indépendance et au commandement […][24]. » Pour y arriver, il suffit que tous ceux qui en sont capables se délient des dogmes qui briment leur véritable liberté et cessent d’être obsédés par la pitié, à la fois à l’égard des autres et de soi-même. Nietzsche considère que « toute élévation du type humain a été l’œuvre d’une société aristocratique […] ; autrement dit, elle a été l’œuvre d’une société hiérarchique qui croit en l’existence de fortes différences entre les hommes[25] ». Considérant que les inégalités sociales sont naturelles, Nietzsche plaide pour une exacerbation de toutes les pulsions et de tous les instincts constituant la Volonté de puissance[26], un idéal auquel devraient aspirer tous les humains.
Nietzsche a fait cinq conférences sur l’éducation, regroupées dans L’avenir de nos établissements d’enseignement, où il critique le système d’éducation de son époque en présentant un dialogue entre un philosophe et son apprenti, qui reflète sa philosophie. Dans ce récit, Nietzsche considère que « les plus graves faiblesses de [son] temps sont justement liées à ces méthodes antinaturelles d’éducation[27] ». Ainsi, il est primordial d’opter pour des techniques de pédagogie respectant la nature humaine, soit la hiérarchie naturelle entre les humains. Partant du point où l’humain apprend la culture à l’école[28], Nietzsche explique que deux tendances sont néfastes à son développement : la tendance à élargir autant que possible la culture et la tendance à la réduire et à l’affaiblir[29]. Concernant l’éducation étatique, Nietzsche considère que « [l’État] veut attirer à lui des fonctionnaires utilisables le plus tôt possible et s’assurer, par des examens excessivement contraignants, de leur docilité inconditionnelle[30] ». Ainsi, il considère que l’éducation étatique n’est qu’une usine à produire des citoyens qui lui permet de se renforcer. Nietzsche prétend plutôt que le but ultime de l’éducation est d’offrir une véritable Bildung, qui s’assure de faire de l’individu la meilleure version de lui-même. Critiquant violemment la qualité de l’enseignement à son époque, il écrit :
Il existe maintenant presque partout un nombre si excessif d’établissements d’enseignement d’un haut niveau qu’on y utilise toujours beaucoup plus de maîtres que la nature d’un peuple […] ne peut en produire ; il arrive donc dans ces établissements un excès de gens qui n’ont pas la vocation, mais qui peu à peu […] déterminent l’esprit de ces établissements[31].
Devant ce constat, Nietzsche propose de réduire considérablement le nombre d’établissements d’enseignement, puisque « la nature elle-même n’a destiné à aller réellement vers la culture qu’un nombre infiniment restreint d’hommes[32] ». Enfin, Nietzsche critique l’éducation démocratique, voire même simplement étatique, puisqu’il considère que « l’éducation et la culture populaire » sont implantées en raison de la crainte qu’a le gouvernement de la nature aristocratique des citoyens[33].
Il est évident que Nietzsche s’opposerait fortement à l’objectif du gouvernement québécois qui est de favoriser l’accès à l’éducation supérieure. Non seulement s’opposerait-il à l’éducation étatique en soi, mais il considérerait la réforme de l’an 2000 comme étant une aberration, puisque tout au long de son œuvre, il indique que seules les connaissances peuvent faire de l’individu un être véritablement cultivé. De plus, un des objectifs de l’éducation fondée sur l’expérience est de favoriser l’autonomie des étudiants dans leur vie de tous les jours. Ce concept est réfuté par Nietzsche alors qu’il écrit : « Nos étudiants « autonomes » vivent sans philosophie, sans art […]. […] Car retirez les Grecs en même temps que la philosophie et l’art : par quelle échelle voulez-vous encore monter vers la culture[34] ?» Ainsi, l’objectif principal de l’éducation démocratique, qui est de développer l’autonomie tout en élargissant le plus possible l’accès à la culture, est vue par Nietzsche comme étant la cause des maux et de la faiblesse de la société. C’est donc la vulgarisation excessive des matières enseignées, ayant pour objectif de favoriser le succès d’un grand nombre d’étudiants, qui fait perdre tout sens à la réelle culture. Il va encore plus loin dans cette lancée et écrit :
C’est l’autonomie véritable, qui, à ces excitations prématurées, ne peut justement s’exprimer qu’en maladresse, en saillants et en traits grotesques, c’est donc l’individu pris exactement qui est réprimandé par le maître et rejeté au profit d’une moyenne décente, privée d’originalité. En revanche la médiocrité uniformisée reçoit des louanges […][35].
Pour Nietzsche, le but de l’éducation est évident : permettre aux plus forts de s’émanciper et d’avoir accès à une véritable culture. Pour cela, il est primordial de limiter l’accès à l’éducation aux seuls individus qui ont à cœur leur épanouissement culturel. Les établissements d’éducation doivent également nourrir le désir d’immortalité des étudiants, afin que cette volonté d’être toujours la meilleure version d’eux-mêmes se traduise par le renversement de toutes les valeurs et le début de la surhumanité.
Le modèle idéal
Il est de mon avis que, globalement, la position nietzschéenne par rapport à l’éducation est la plus enrichissante, de par l’importance qu’elle accorde à la culture. La transmission de connaissances dans un processus académique rigoureux est, selon moi, idéale, puisque le sérieux accordé à l’éducation permet aux étudiants d’acquérir assez de connaissances pour être réellement épanouis intellectuellement. Donc, le type d’éducation nietzschéen, soit un système où l’élite est grandement valorisée, semble être le plus efficace pour avoir de réels établissements axés sur une Bildung contemporaine. Or, la mise en pratique d’un tel système comporte certaines lacunes qui doivent être parées. En effet, la solution à la « crise de l’éducation » serait pour lui de restreindre énormément l’accès aux études supérieures afin d’avoir de meilleurs professeurs et des étudiants plus doués. Bien qu’une certaine forme d’élitisme soit acceptable, voire même souhaitable, dans nos établissements scolaires, il est impératif de veiller à ce qu’il existe une réelle égalité des chances dans notre société. Ainsi, je suis en grande partie d’accord sur le type d’éducation que la société doit fournir, mais pas sur la manière d’y arriver. Par rapport à la problématique, je considère aussi que le fait d’avoir pour objectif de favoriser l’accès aux études supérieures au plus grand nombre entraine inévitablement une perte de la qualité de l’éducation dans son ensemble.
Par rapport à Mill, je considère que sa position sur l’importance de l’individualité est, comme chez Nietzsche, très pertinente et que sa mise en application est plus réalisable que chez ce dernier. En effet, la mise en place d’un système d’enseignement accessible à tous, mais qui relève de l’initiative privée est, en bonne partie, une solution viable permettant d’assurer que la volonté de tous soit bel et bien respectée. Néanmoins, cette mesure comporte certaines lacunes. En effet, elle implique que certains établissements puissent fournir une éducation de moins bonne qualité aux étudiants les moins favorisés. Je considère plutôt qu’il faut qu’une grande partie de l’éducation soit financée par l’État, tout en laissant davantage de liberté aux institutions afin que les programmes soient plus diversifiés et que les étudiants aient davantage de liberté pour choisir le programme. Par rapport à l’importance que Mill accorde aux compétences pour bien développer l’individu, je suis en partie d’accord, bien que je considère que les connaissances doivent jouer un plus grand rôle dans l’éducation.
Concernant Dewey, il me semble que certains éléments de sa philosophie soient absolument essentiels à un bon système d’éducation. En effet, son idéal d’égalité des chances doit être au cœur de notre système et cela ne peut se faire qu’en ayant un État soutenant financièrement les enfants n’ayant pas les moyens de s’éduquer. De plus, l’idée de permettre une éducation diversifiée, dans le sens où les établissements d’enseignement encourageraient la présence d’étudiants provenant de divers milieux socioéconomiques et culturels, est, à mon sens, extrêmement importante, puisque cela permet aux jeunes de partager différentes expériences et de mieux comprendre la réalité dans laquelle les autres vivent. Néanmoins, je considère que d’inclure dans le cursus des activités basées sur les expériences des étudiants n’est pas bénéfique, puisqu’ils le feront en dehors des heures de cours. Il est donc primordial de garder la grande majorité de ces heures pour le partage de connaissances.
Je considère que le meilleur type d’éducation qu’un État peut fournir est un système d’enseignement dans lequel les établissements, bien que largement financés par l’État, sont autonomes tout en devant se plier à des examens communs afin de s’assurer que leur matière est bien enseignée. Cela permettra à chaque étudiant d’étudier dans un programme d’étude qui lui convient réellement. De plus, je considère que la majorité du cursus doit être axé sur la transmission de la culture par la connaissance, tel que Nietzsche le défend. Les compétences et les expériences peuvent aussi être développées par les établissements grâce à l’usage de jeux, comme le soutient le philosophe suisse Johann Heinrich Pestalozzi. Si, en dehors des heures de cours, les étudiants ont accès à différents jeux comme, par exemple, les échecs ou des jeux de mémoire, ils pourront développer différentes compétences avec leurs camarades, bien que celles-ci ne soient pas véritablement enseignées par leur établissement. De cette manière, les élèves développeront leur envie d’apprendre et pourront bénéficier des expériences des autres.
Pour conclure, la solution au problème soulevé par la réforme de l’éducation québécoise, à savoir le véritable type d’éducation qu’il faut fournir aux étudiants afin de maximiser leur développement, est, pour Dewey, de prôner une éducation d’abord et avant tout progressiste pouvant permettre à la société démocratique de se délier du passer et de se perfectionner. Il avance que cela ne peut se faire qu’avec une éducation axée sur les compétences et les expériences de chacun. Ensuite, Mill considère que l’éducation ne doit ni être carrément progressiste ni franchement conservatrice ; elle doit permettre à chacun de choisir quelle sorte d’éducation elle ou il souhaite obtenir. Il soutient ce principe avec ses idéaux libéraux, puisque ce n’est qu’en engageant tous les membres de la société que nous favorisons une réelle éthique de la discussion, nous rapprochant ainsi de la vérité. Enfin, Nietzsche affirme qu’il est primordial que les établissements d’enseignement servent à transmettre une véritable Bildung afin de former des êtres cultivés. Selon moi, l’éducation se doit d’être un hybride entre ces trois modèles en la rendant réellement accessible à tous afin d’offrir une réelle égalité des chances, en offrant davantage de libertés aux établissements eux-mêmes pour que les étudiants soient libres de choisir ce qu’ils veulent étudier et en mettant davantage d’accent sur la transmission de la culture. En ce qui concerne les cégeps, ils devraient concentrer leurs efforts sur la transmission de la culture, ce qui implique l’imposition de davantage de cours de formation générale visant à faire naître chez les étudiants un réel désir de devenir la meilleure version de soi-même.
[1] Hannah ARENDT, L’Humaine Condition, Paris, Gallimard, 1972, p.749.
[2] COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE SUR L’ENSEIGNEMENT DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC, Rapport Parent : Deuxième partie ou tome 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993, [http://classiques.uqac.ca/contemporains/quebec_commission_parent/rapport_parent_2/rapport_parent_vol_2.pdf], (page consultée le 2 avril 2018).
[3] Damion SEARLS, cité par Josh JONES, « Nietzsche Lays Out His Philosophy of Education and a Still-Timely Critique of the Modern University (1872) », dans Open Culture : Education, Philosophy, 20 janvier 2016, [http://www.openculture.com/2016/01/nietzsches-philosophy-of-education-and-a-still-timely-critique-of-the-modern-university-1872.html], (page consultée le 5 novembre 2017). (Traduction libre)
[4] John DEWEY, Démocratie et Éducation suivi de Expérience et Éducation, Paris, Armand Colin, 2011, p.83-84.
[5] Ibid., p.397.
[6] Ibid., p.153.
[7] Ibid., p.157.
[8] Ibid., p.158.
[9] Ibid., p.161.
[10] Ibid., p.100.
[11] MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Le renouveau pédagogique : ce qui définit « le changement », octobre 2005, [http://fcsq.qc.ca/fileadmin/medias/PDF/452755.pdf], (page consultée le 19 avril 2018).
[12] Ibid., p.70.
[13] Ibid., p.73.
[14] Ibid., p.78.
[15] Ibidem.
[16] Wilhelm VON HUMBOLDT, cité par John Stuart MILL, op. cit., p.126.
[17] Ibid., p.127.
[18] Ibid., p.178.
[19] Ibid., p.177.
[20] Ibid., p.144.
[21] Ibid., p.178.
[22] Friedrich NIETZSCHE, Par-delà bien et mal et La généalogie de la morale, Paris, Gallimard, 1971, p.183.
[23] Ibidem.
[24] Ibid., p.58.
[25] Ibid., p.180.
[26] Ibid., p.55.
[27] Friedrich NIETZSCHE, Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, Paris, Gallimard, 1973, p.18.
[28] Ibid., p.17.
[29] Ibid., p.19-20.
[30] Ibid., p.39-40.
[31] Ibid., p.78.
[32] Ibid., p.79.
[33] Ibid., p.94.
[34] Ibid., p.132.
[35] Ibid., p.59.
Médiagraphie
Arendt, Hannah. L’Humaine Condition, Paris, Gallimard, 1972, 1056 p.
Boutin, Gérald. « De la réforme de l’éducation au « renouveau pédagogique » : un parcours chaotique et inquiétant », dans Revue Argument [en ligne], v. 9, n. 1, Automne 2006 – Hiver 2007, [http://www.revueargument.ca/article/2006-10-01/367-de-la-reforme-de-leducation-au-renouveau-pedagogique-un-parcours-chaotique-et-inquietant.html], (page consultée le 5 novembre 2017).
Bronckart, Jean-Paul. « Didactique : Vue d’ensemble », dans Universalis [En ligne], [https://universalis-bdeb.proxy.ccsr.qc.ca/encyclopedie/didactique-vue-d-ensemble/], (page consultée le 5 novembre 2017).
COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE SUR L’ENSEIGNEMENT DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC. Rapport Parent : Deuxième partie ou tome 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993, [http://classiques.uqac.ca/contemporains/quebec_commission_parent/rapport_parent_2/rapport_parent_vol_2.pdf], (page consultée le 2 avril 2018).
Dewey, John. Démocratie et Éducation suivi de Expérience et Éducation, Armand Colin, Paris, 2011, 516 p.
Jones, Josh. « Nietzsche Lays Out His Philosophy of Education and a Still-Timely Critique of the Modern University (1872) », dans Open Culture : Education, Philosophy, 20 janvier 2016, [http://www.openculture.com/2016/01/nietzsches-philosophy-of-education-and-a-still-timely-critique-of-the-modern-university-1872.html], (page consultée le 5 novembre 2017).
Mill, John Stuart. De la liberté, Montréal, Éditions CEC, 2013, 199 p.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, Le renouveau pédagogique : ce qui définit « le changement », octobre 2005, [http://fcsq.qc.ca/fileadmin/medias/PDF/452755.pdf], (page consultée le 19 avril 2018).
Nietzsche, Friedrich. Par-delà bien et mal et La généalogie de la morale, Paris, Gallimard, 1971, 399 p.
Nietzsche, Friedrich. Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, Paris, Gallimard, 1973, 154 p.