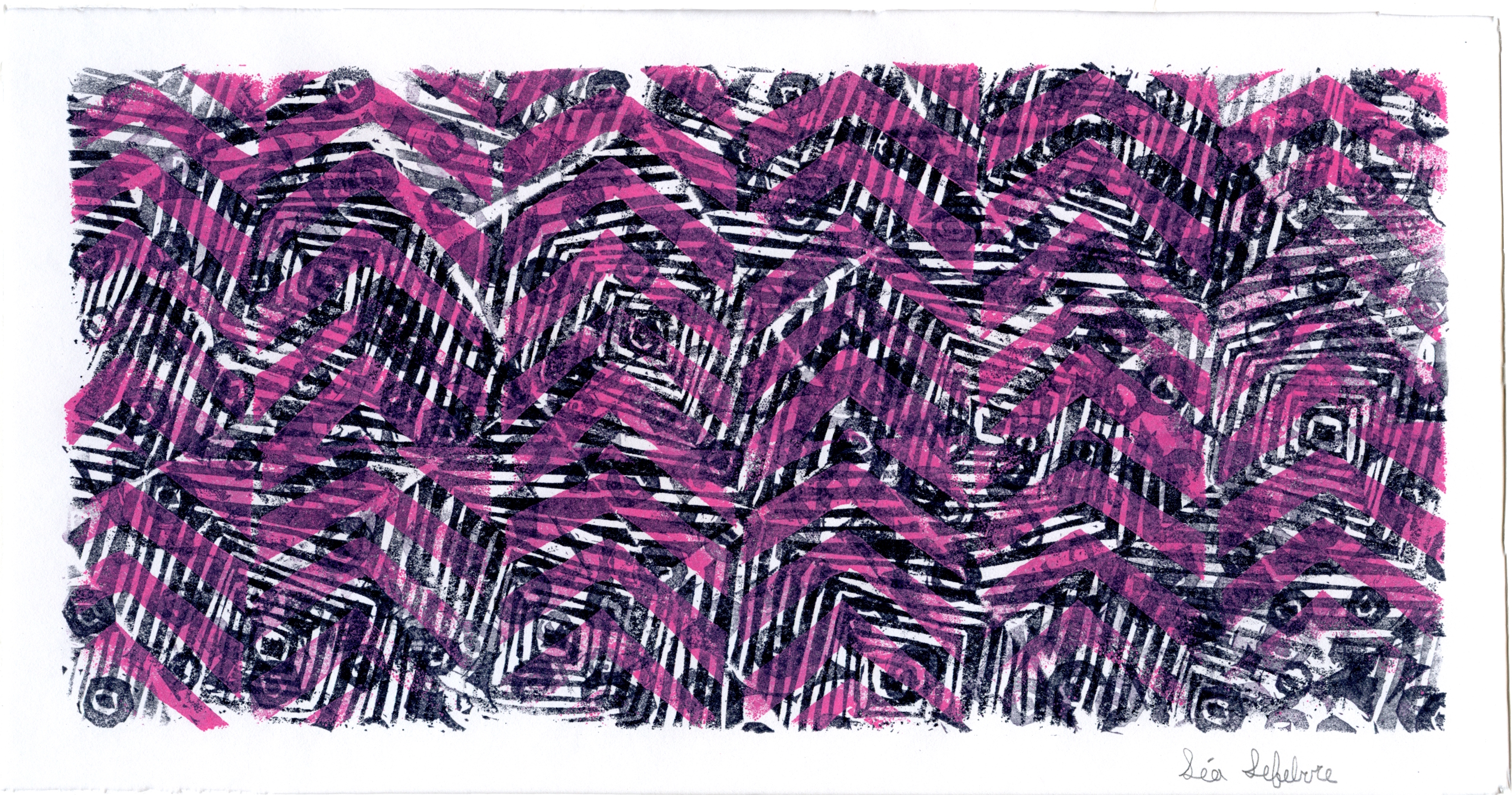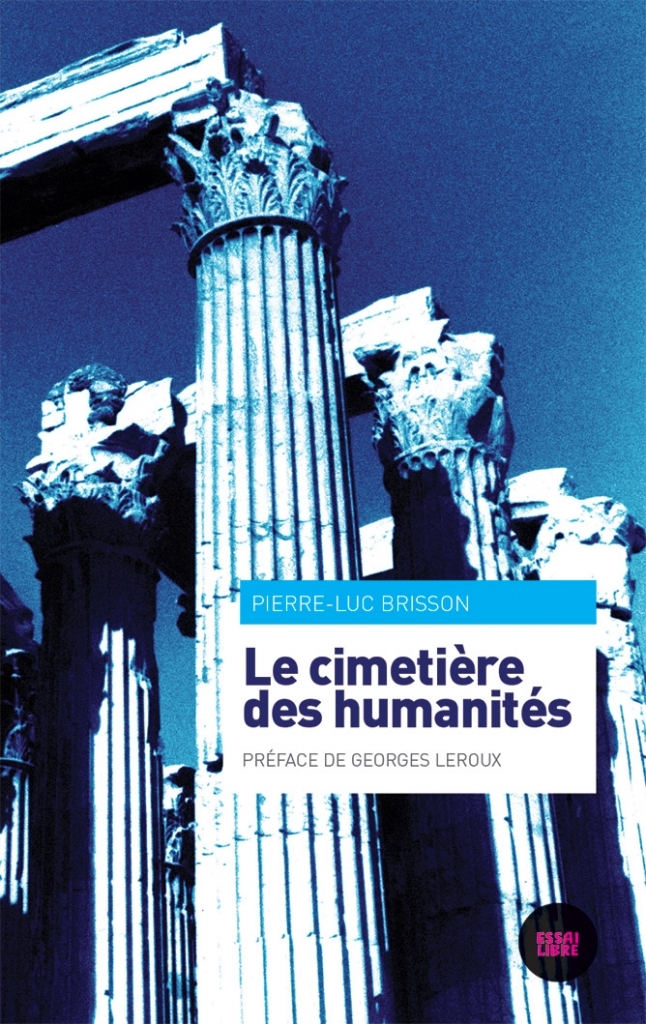Crédit photo: Daphnée Leclerc, Nature morte, 2023.
Cégep Ahuntsic, avril-mai 2022
Nicolas Bourdon
Il la voyait tous les mardis et il sortait bouleversé de son bureau.
Elle avait 27 ans, le même âge que lui, mais on eût dit qu’ils n’étaient pas de la même génération.
Il y avait un an de cela, elle avait bien sûr voté « oui » à une proposition qu’il jugeait « multiculturelle ». Le département de français de son cégep s’était rajeuni et il s’en était suivi un « rafraîchissement » (il appelait plutôt cela un « acte de barbarie ») du contenu des cours.
Les deux cours de littérature française avaient été évacués ; le libre-choix avait triomphé : les professeurs pouvaient mettre au programme de leurs cours les œuvres qu’ils souhaitaient enseigner peu importe leur provenance. Un de ses collègues ne mettait que des œuvres traduites de l’anglais dans son cours de littérature 101. Plusieurs étudiants les lisaient dans leur langue originale, car ils étaient meilleurs en anglais qu’en français. « En fait, songeait-il, c’est le triomphe du plus fort et qui dit « plus fort » dit « anglais », la langue dominante. »
Il s’était retrouvé seul avec quelques collègues de soixante ans à défendre les cours de littérature française : on eût dit la querelle des Anciens et des Modernes. Sans surprise, elle avait voté avec les Modernes.
Il marchait dans les corridors sans âme de son cégep en ruminant de sombres pensées. Il entendait de plus en plus d’étudiants parler anglais : « On se croirait à New York ! Le Québec a changé à une vitesse folle ces dix dernières années. Mon cégep a changé à une vitesse folle ! Nous sommes devenus des Américains. Même les profs de français consomment une quantité phénoménale de séries télé américaines ! Plus personne ne lit, même les profs de littérature ! Mes collègues ne connaissent rien à l’histoire du Québec et ils ont enterré pour de bon le rêve de l’indépendance. Ils parlent de décolonisation et d’autochtonisation, mais ils sont branchés à fond sur les États-Unis. Cherchez l’erreur… Ils ont d’autres héros, d’autres modèles, moi, j’en suis encore à Bourgault, Lévesque et Parizeau. »
Il avait déjà discuté avec elle, mais toujours en compagnie d’autres professeurs. Les conversations, mornes, prévisibles, tournaient autour de la pédagogie et des interminables corrections. On fustigeait bien sûr l’incurie de la direction et quand on se risquait à parler de politique, tout le monde s’entendait pour haïr la CAQ. Même lui qui était reconnu pour son humour irrévérencieux et iconoclaste n’osait pas briser le monolithisme du groupe.
Il la jugea au départ assez sévèrement. « C’est une fanatique. Une végane. Elle se fait des lunchs tristes comme la pluie. Du tofu, du riz, du brocoli. Mon Dieu ! Qui a envie de manger ça ? Et ses vêtements ! On ne devine aucune courbe, aucune féminité. Des couleurs ternes… On dirait qu’elle s’habille avec la garde-robe de Françoise David. »
En groupe, elle parlait peu, semblait timide. Elle se contentait de quelques remarques pertinentes et très précises. « Bon, songea-t-il, c’est une scientifique de la littérature. C’est une fille bien sérieuse, bien rangée comme on en a beaucoup dans notre département. »
À la session d’hiver 2022, ils terminaient leur cours à midi et le hasard fit qu’ils étaient les seuls à manger à cette heure-là. « Par pure politesse, je vais quand même lui demander si elle veut dîner avec moi, elle va dire « non » ; c’est une sorte d’animal à sang froid celle-là ! En fait, c’est sans doute mieux ainsi, je vais sans doute m’ennuyer à mourir en sa compagnie. »
Mais elle dit « oui » et l’invita cordialement à dîner. Une atmosphère monacale régnait dans son bureau. Aucun document ne traînait ; tout était savamment rangé dans des classeurs. La conversation languissait et était ponctuée de nombreux silences, mais, pour la provoquer, lorsqu’elle eut le dos tourné (elle réchauffait sa sauce à spaghetti aux lentilles), il se leva, s’empara de son arrosoir et s’approcha d’un beau vase contenant une grosse plante araignée.
Elle se retourna juste au moment où il allait verser de l’eau. « N’y touchez pas, il est brisé !
– Quoi ? Tu connais ce poème ? » Il la regardait avec le même émerveillement qui subjugua les apôtres quand ils virent Jésus ressuscité. C’est ce qu’il écrivit le soir dans son journal personnel. Il se faisait en effet une fierté de ne pas avoir renié son héritage catholique contrairement aux progressistes.
« Ça te surprend ? lui demanda-t-elle
– Enfin, je ne pense pas me tromper en disant que tu es une spécialiste de l’anticolonialisme, enfin de tout ce qui est anti-occidental…
– Et moi je pense que tu es un spécialiste du nationalisme réactionnaire ! »
Une tension s’élevait entre eux, mais, soudain, elle éclata d’un grand rire qu’il ne lui avait jamais entendu, et elle continua :
« Toujours intact aux yeux du monde,
Il sent croître et pleurer tout bas
Sa blessure fine et profonde ;
Il est brisé, n’y touchez pas. »
– Mon Dieu ! s’exclama-t-il intérieurement, ce n’est pas possible. Elle sait le poème par cœur.
Elle le regardait avec un sourire de défi… Ou bien était-ce peut-être un sourire amoureux ? Il ne pouvait le deviner.
Une semaine plus tard, ils discutèrent encore de littérature et, à sa grande surprise, elle lui apprit qu’elle adorait Balzac ! C’était quand même bien mieux qu’une autre de ses collègues qui, lorsqu’il lui avait avoué son amour du grand écrivain, lui avait répliqué : « Il est temps de faire lire à nos étudiants autre chose que des vieux hommes blancs ! »
« Mais pourquoi as-tu voté pour la proposition qui supprime les deux cours de littérature française ?
– Je voulais faire un peu de place à autre chose.
– As-tu remarqué que les profs ont mis de la littérature anglaise à la place ? On nous a dit qu’on veut se débarrasser d’une littérature impérialiste, mais on la remplace par la littérature la plus impérialiste qui soit ! Et nos étudiants qui sont toujours dans l’anglais… Est-ce qu’on ne peut pas les sortir un peu de l’anglosphère ?
– Si j’avais su, je n’aurais peut-être pas voté pour la proposition, dit-elle avec une désarmante humilité.
Ce jour-là, il sortit de son bureau en proie à une douce rêverie et lut à ses étudiants le poème « Green » de Verlaine avec un peu plus d’émotion qu’à l’habitude :
« Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et branches
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous […] »
À la fin de la journée, il dut s’avouer que cette « douce rêverie » s’était métamorphosée en amour.
Je l’aime ! écrivit-il dans son journal personnel. Enfin, pas beaucoup. Un peu seulement. Il ne faut pas trop s’emballer. Disons simplement que j’ai une petite inclination envers elle qui pourrait disparaître aussi rapidement qu’elle est apparue.
Le mardi suivant, ce fut le cœur rempli d’espoir qu’il se présenta à son bureau. Elle lui révéla pourtant qu’elle avait écrit son mémoire de maîtrise sur un chanteur de hip-hop américain. Il eut un mouvement de recul comme s’il avait soudainement aperçu une immondice.
« Hé merde ! On a créé l’UQAM en 1968 pour les francophones, pour qu’ils fassent des études supérieures dans leur langue maternelle, mais c’est devenu une machine à assimilation comme Concordia et McGill. As-tu écrit ta maîtrise en français au moins ?
– Oui, mais 95 % de mes sources sont en anglais », dit-elle en pouffant de rire.
Ce midi, j’étais en maudit de voir qu’une fille intelligente comme elle dilapide son talent et nos impôts pour obtenir une maîtrise en hip-hop. Pourquoi ne va-t-elle pas faire ses études à New York tant qu’à y être ? Mais il y a son rire ! Je pensais pourtant que les wokes avaient hérité de la gravité des puritains.
Il prit une pause, marcha un moment dans le corridor de son appartement, sortit sur son balcon arrière et vit, dans la cour de ses propriétaires, que les bourgeons du magnolia avaient grossi.
Il revint à son bureau et écrivit dans son journal :
L’idéologie finit là où la littérature commence.
Il était fier de cette maxime ; il lui semblait qu’un grand écrivain aurait pu l’écrire ! Mais en même temps, il n’était pas plus avancé. Il était amoureux et ce n’étaient pas de belles maximes qui allaient ravir son coeur. Et au fond sa maxime était-elle si véridique ? Il y avait des limites quand même : un nationaliste et une multiculturelle pouvaient sans doute casser la croûte ensemble, mais de là à tomber en amour ?

Crédit photo: Jia Yue Yang, Nature morte, 2022.
Le mardi suivant, on eût dit qu’elle prenait les devants et que c’était elle qui lui faisait une déclaration d’amour ! Elle lui annonça qu’elle présentait des poèmes de Gaston Miron à ses étudiants.
« De quoi réjouir mon vieux nationaliste grincheux ! »
Elle le regardait d’un air mutin comme si elle voulait l’inviter à commettre un coup pendable avec elle.
Mais mal lui en prit : il ne put s’empêcher de disséquer son amour pour Miron. « Je te gage que tu veux dépayser Miron, non ? Tu n’as rien à cirer de son engagement pour la langue française, de son engagement pour l’indépendance… Je te gage que tu es fédéraliste ou plutôt que tu es indifférente à la question, ce qui est peut-être même pire…
– Je suis plutôt indépendantiste, mais je ne partage pas les valeurs de beaucoup d’indépendantistes ! Si être indépendantiste, ça signifie d’enlever des droits aux femmes voilées, oubliez-moi !
– La loi 21 est plutôt modérée ! »
S’en suivit une longue conversation où leur désaccord éclata au grand jour.
Le soir, il écrivit dans son journal : Tout est fini ! Nous sommes trop différents.
Son aveu l’accabla ; une lourde fatigue monta en lui.
Il est plus facile de déplacer des montagnes que de changer des convictions. On a l’illusion du changement, alors que le monde est stable, immobile. C’est la répétition infinie du statu quo.
Il sombra dans un sommeil profond, mais il se réveilla soudainement trois heures plus tard et, en proie à une étrange fébrilité, il écrivit dans son journal :
Ne dit-on pas que Cupidon, dieu fantasque s’il en est, se plaît à unir les êtres les plus dissemblables qui soient ?
On était à la mi-avril. Les crocus et les jonquilles commençaient à se frayer un chemin entre des couches de neige sales. Il voulut croire à un dégel et écrivit un article, qui fut publié dans Le Devoir, où il souhaitait de tout son cœur une alliance entre les nationalistes et les progressistes pour libérer le Québec de la stagnation politique où il s’était englué. « Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. On me dira qu’un océan nous sépare, que l’amertume, les coups assénés de part et d’autre, les blessures et les rancunes rendent impossible notre union, à cela, je réponds : « À cœur vaillant, rien d’impossible ! » » Ce cri du cœur, cet appel au dépassement, revenait d’ailleurs à trois reprises dans son texte.
Bon, c’est peut-être redondant, avait-il noté dans son journal, mais j’aime l’idée du cœur, de l’émotion, de la passion… Je m’aperçois seulement maintenant que ce texte n’est pas seulement politique, c’est une lettre d’amour ! Je vais lui envoyer. Elle va saisir l’allusion ; c’est une fine psychologue.
Il reçut un courriel où elle lui dit simplement « Merci ! ». À la droite de son nom, elle avait écrit les pronoms : « elle – she – her »
« Cette fille est insupportable ! »
Leur dîner suivant fut pénible. Elle parlait peu et semblait fatiguée. « C’est la fin de session ; elle a beaucoup d’étudiants, beaucoup de corrections », songea-t-il pour se rassurer. Après un peu moins d’une demi-heure, leur dîner, qu’il avait espéré « romantique », était terminé ; il fallait qu’elle retourne à ses corrections.
La semaine suivante, ce fut pire. La conversation roula sur les séries télé ; il déplora bien sûr « l’américanisation du Québec », mais elle lui répliqua sur un ton moqueur : « Je regarde au moins quinze heures de Netflix par semaine. J’ai malheureusement dû diminuer à cause des corrections. » Elle lui parla longuement de ses séries préférées. Il s’efforçait de l’écouter, mais songeait : « Mon article ! Pourquoi est-ce qu’elle ne me parle pas de mon article dans Le Devoir ? »
Elle lui parla aussi avec conviction de la force prophétique de la fiction : « Margaret Atwood avait vu les choses venir avec son Handmaid’s Tale : tu vas voir, la Cour suprême va bientôt invalider l’arrêt Roe v. Wade sur l’avortement. – Oui, oui, d’accord pensait-il, mais mon article ? Mon article ? »
Le soir, de retour à son appartement, il écrivit dans son journal :
Ce n’est quand même pas rien ! J’ai été publié par un grand journal. Je te gage qu’elle a seulement publié des textes dans une feuille de chou de l’UQAM.
Il fit une recherche sur Google et découvrit qu’elle avait été publiée trois fois par Le Devoir et deux fois par La Presse. « Hé merde ! C’est mieux que moi. »
Il se présenta au dîner suivant le cœur lourd. « Si c’est aussi pénible que la dernière fois, je la laisse manger son tofu toute seule et je mange mon sandwich au jambon dans mon bureau en regardant un discours de Bourgault sur You Tube. »
Elle lui parla du bénévolat qu’elle effectuait dans une maison d’hébergement pour femmes. Il admira son dévouement, mais intérieurement, il criait : « Mon article ? Rien sur mon article ! » Il y eut un long silence ; ils avaient tous deux fini leur repas. « Bon, on n’a sans doute plus rien à se dire », songea-t-il.
Il se leva, ramassa les restes de son lunch et lui souhaita bonne chance pour la correction de la dissertation finale.
« J’avance assez vite maintenant que je n’ai plus de préparation de cours à faire, lui dit-elle. J’en corrige une bonne quinzaine par jour.
– Quinze ! C’est énorme ! J’arrive à peine à en corriger dix sans avoir la nausée.
– À cœur vaillant, rien d’impossible !
– Mais, mon Dieu, tu as lu… »
Elle lui souriait et opinait de la tête.
– J’étais certain que tu t’arrêterais aux premières lignes.
– À cœur vaillant, rien d’impossible ! »
De retour à la maison, il écrivit dans son journal :
Calmons-nous, il y a loin de la coupe aux lèvres. Son deuxième « À cœur vaillant, rien d’impossible ! » m’est suspect… Lire mon article est une corvée, mais elle a pris son courage à deux mains et elle en est venue péniblement à bout ! En fait, cette blague, son sourire moqueur, c’est un message subtil de rejet.
Il sortit sur son balcon arrière. Un vif soleil de fin d’après-midi rendait éclatantes les belles fleurs roses du magnolia. Il revint à son bureau et écrivit :
Et pourtant, il y a peut-être de l’espoir ! Un très mince espoir !